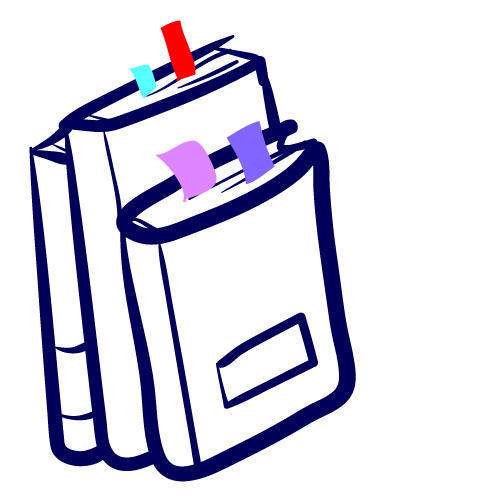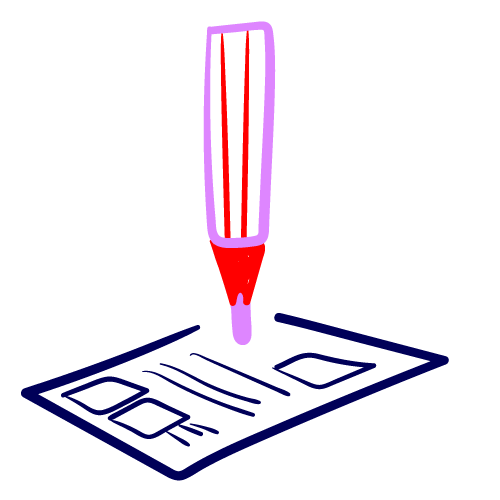La place des femmes dans les musiques trad'aujourd'hui - Rencontres professionnelles d'Eurofonik, 12 mars 2021 Actes des rencontres professionnelles d'Eurofonik qui ont eu lieu le 12 mars 2021, organisées par le Nouveau Pavillon (Nantes) et la FAMDT, fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles. Ces cinquièmes rencontres ont pris pour thème la place des femmes dans les musiques traditionnelles. S’appuyant sur plusieurs témoignages d’artistes, d’actrices et acteurs culturel·le·s, elles posent les premiers jalons d’une réflexion de fond sur le sujet : quelle place notre monde du trad’actuel, héritier d’un revivalisme folk issu de la contre-culture des années 60 et 70, et proche des idées féministes, accorde-t-il réellement aux femmes en France et en Europe ?