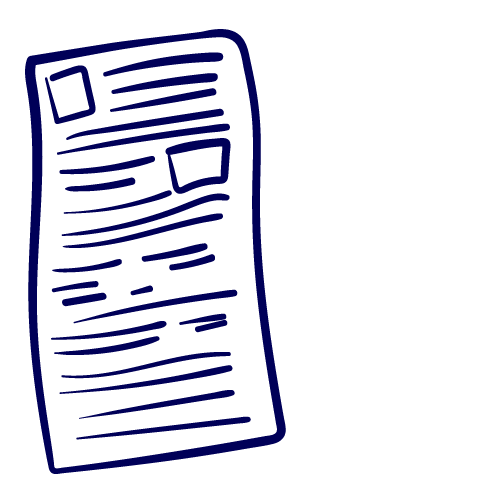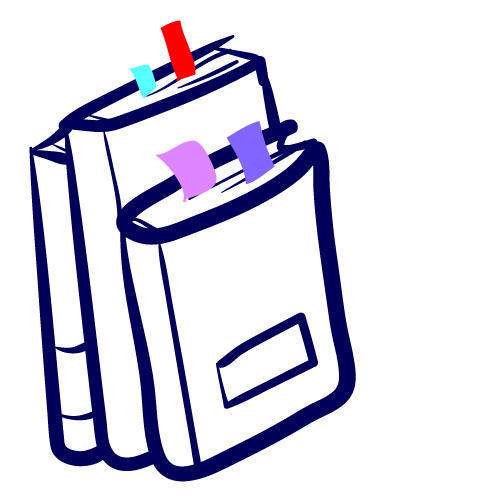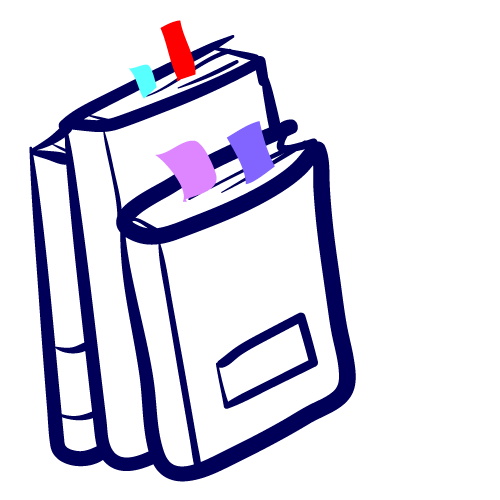
" La professionnalisation des musiciennes est un phénomène ancien, qui a vu un développement fulgurant à partir de la fin du XVII siècle, avec l’apparition du genre de l’opéra. Le goût du public français, en particulier, pour les voix de femmes et la vérité théâtrale (et donc son refus des castrats) a permis l’apparition de véritables divas, rémunérées en conséquence, peut-être les premières femmes à avoir eu accès aux professions dites de prestige. Le Conservatoire de Paris a été dès sa création, en 1795, ouvert aux deux sexes, permettant à des chanteuses et à des pianistes d’acquérir un diplôme convoité, cent ans avant l’École des beaux-arts et soixante-dix avant les universités. Pour les autres métiers de la musique, l’accès des femmes s’est révélé plus difficile, comme pour les professions considérées comme des « domaines masculins » ; si les instrumentistes solistes ont pu s’imposer au cours des siècles, les instrumentistes d’orchestre, les cheffes et les compositrices, perçues d’abord comme des « exceptions » puis comme des concurrentes, rencontrent encore de nos jours des problèmes de légitimité et de discrimination. La pédagogie de la musique a été par contre investie tôt par les femmes, à cause du poids considérable des « arts d’agrément », passage obligé de l’éducation des femmes de la bourgeoisie, les femmes devant enseigner aux femmes. Les métiers de la musique se révèlent ainsi un champ idéal d’observation de l’historique des discriminations professionnelles par le sexe. "